Avant-propos
Pleinement dans son rôle de fédération de recherche et d’animation, la Fédération Nanosats lance une toute nouvelle série de séminaires en ligne entièrement dédiée aux projets de nanosatellites scientifiques. Chaque second jeudi du mois à partir du mois de novembre, des scientifiques et ingénieurs de renom seront invités pour présenter leur projets, leurs principaux résultats et partager leur expérience. Une occasion inédite et un rendez-vous mensuel unique réunissant des experts internationaux du newspace scientifique.
De l’étude de la Terre et de son environnement à l’observation de l’univers, que le nanosatellite soit lancé seul ou en constellation, découvrez – à travers cette série de séminaires – des projets parmi les plus prometteurs et des témoignages de personnes impliqués dans des programmes expérimentés.
Programme
Automne

13 novembre, 2025
La constellation BRITE: un satellite de la taille d’une boîte à chaussure pour la recherche d’étoiles variables
During their 12 years in space, the five BRITE-Constellation nano-satellites have completed observations of about 730 individual targets typically brighter than about 6th magnitude. The data have allowed us to study a variety of variability phenomena covering a wide range across the HR-diagram including different types of pulsations, wind phenomena, rapidly rotating stars (e.g. Be), binary and multiple systems, and stars with planets. Some of the prime science results therefore comprise the discovery of massive heartbeat systems, the apparent interaction of phenomena on very different time scales in Be stars, observations of a Nova, or the presence of only two pulsation modes in a magnetic delta Scuti star.
I will give an overview of the BRITE-Constellation mission and show selected highlights of the scientific results achieved with BRITE-Constellation data.
Konstanze Zwintz, Université d’Innsbruck
est professeure à l’université d’Innsbruck. Ses recherches portent sur l’amélioration de la description de l’évolution stellaire précoce à travers les pulsations. Elle est membre de l’équipe scientifique exécutive de BRITE-Constellation et contribue à la mission depuis ses débuts.
11 décembre, 2025
Des nanosatellites pour les sciences spatiales
Au cours des 25 années qui ont suivi leur introduction, les nanosatellites sont passés du statut de petits projets éducatifs à celui de missions à part entière. L’université du Colorado à Boulder participe au programme CubeSat depuis près de 20 ans et se spécialise principalement dans les missions scientifiques. Au moins neuf missions dirigées par l’université ont été lancées et menées à bien, et sept autres sont en préparation pour un lancement dans les deux prochaines années. Ces missions couvrent des objectifs scientifiques variés, allant de l’observation des rayons X solaires à la mesure des ceintures de radiation, en passant par les ondes électromagnétiques dans l’espace, les champs magnétiques, l’astrophysique et les exoplanètes, entre autres.
Dans cette présentation, je donnerai un aperçu de l’approche de l’université de Boulder en matière de missions CubeSat, en mettant l’accent sur trois missions qui ont été développées en parallèle au cours des quatre dernières années. Je décrirai comment ces missions ont été conçues et attribuées, leurs objectifs scientifiques et leur processus de développement. Je décrirai également l’avenir des CubeSats destinés à la science spatiale à l’université de Boulder et ailleurs.
Robert Marshall, Université du Colorado
est professeur et étudie la haute atmosphère terrestre, l’ionosphère et l’environnement radiatif à travers la modélisation, l’analyse de données et le développement d’instruments. Il dirige actuellement le développement de trois missions CubeSat ayant des objectifs scientifiques différents, dont le lancement est prévu début 2026.
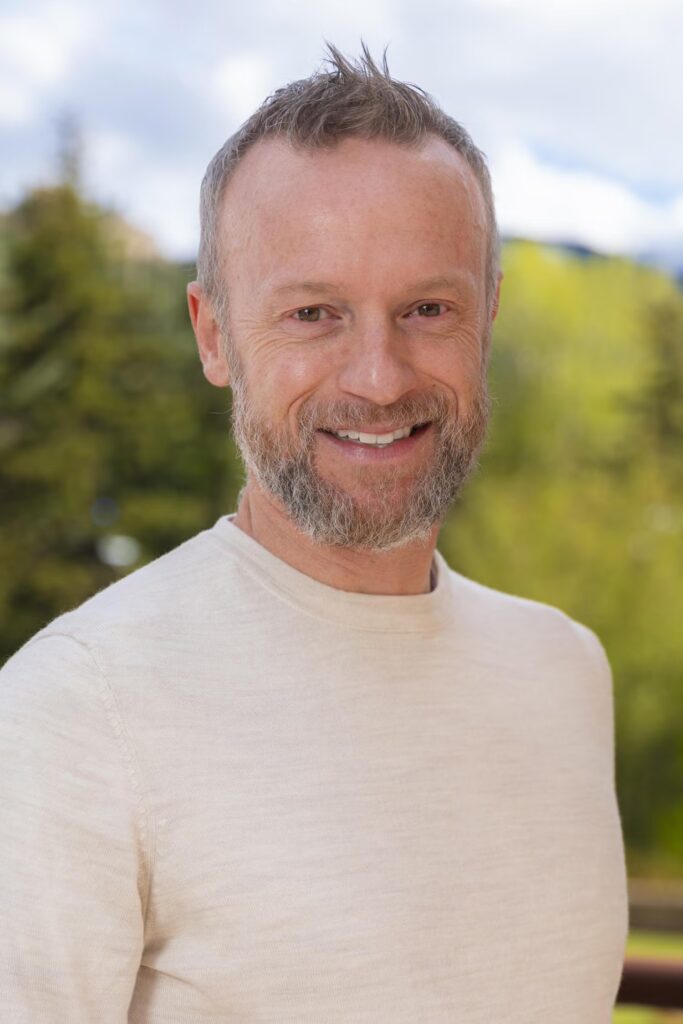
Hiver

08 janvier, 2026
L’aventure ROBUSTA-3A : concevoir, tester et opérer un CubeSat 3U pédagogique et technologique à visée scientifique
Le Centre Spatial de l’Université de Montpellier (CSUM) a lancé ROBUSTA-3A (Méditerranée), son premier CubeSat 3U contrôlé 3axes, sur le vol inaugural de Ariane 6 à l’été 2024. Sa mission principale consiste à relayer des données météorologique depuis des balises embarquées en mer, jusqu’à Météo France, en passant par la station sol de Montpellier, afin d’aider à la prévision des épisode cévenols. Le satellite embarque également une expérience de mesure des effets des radiations sur des mémoires électroniques.
Ce CubeSat, comme les autres satellites du CSUM, est entièrement développé en interne et grâce à l’implication de plusieurs centaines d’étudiants et des ingénieurs de la structure. Il a été intégré et testé au sein du CSUM, à l’aide des équipements et des infrastructures de test développés et opérés sur place : banc de test système, pot vibrant, chambre de vide thermique, etc… et est actuellement opéré depuis le segment sol UHF et Bande S du CSUM.
Après plus d’un an en orbite, cette présentation propose un premier retour d’expérience sur la conception, les tests et la validation, ainsi que les opérations de ce premier CubeSat 3U Montpelliérain : de la complexité des phases AIT, aux anomalies potentiellement « mission-killer » en orbite et leur résolutions.
Laurent Dusseau, CSUM
est Directeur du Centre spatial université Montpellier Nîmes et de la Fondation Van Allen qu’il a respectivement créés en 2011 et 2012. Professeur à l’université de Montpellier, ses thématiques de recherche portent sur l’effet des radiations sur les composants électroniques des satellites ce qui l’amène dès 2001, à développer une activité nanosatellite à l’Université de Montpellier pour obtenir des données en vol. Il a mené le développement de ROBUSTA, premier CubeSat français lancé en 2012, et coordonne de nombreux projets de satellites.

Tristan Allain, CSUM
est ingénieur spécialisé dans les systèmes spatiaux et possède une expérience dans les plateformes cubesat. Après 6 ans au LISA sur l’instrument MOMA-GC (rover ExoMars Rosalind Franklin) et sur le développement de cubesats étudiants, il a rejoint le CSUM en 2019 en tant qu’ingénieur système. Outre les missions d’éducation et de formation, il coordonne les opérations et la livraison des satellites 1U et 3U CELESTA, MTCUBE-2, ENSO et ROBUSTA-3A, ainsi que des satellites 1U djiboutiens et sénégalais (HYDROSAT, GAINDESAT).
12 février, 2026
Exploration des exoplanètes extrêmes et de l’activité stellaire à l’aide de missions de petits satellites
La fuite atmosphérique est un processus qui affecte la structure, la composition et l’évolution de nombreuses planètes. Les taux de fuite atmosphérique dépendent fortement des flux de photons ultraviolets extrêmes (EUV) et ultraviolets lointains (FUV) provenant de l’étoile hôte. Dans cette présentation, je présenterai les missions actuelles et futures de petits satellites conçues pour observer directement la fuite atmosphérique des exoplanètes et pour étudier la luminosité EUV et la répartition énergétique des éruptions EUV sur les étoiles proches. La majeure partie de la présentation portera sur CUTE, une mission CubeSat 6U conçue pour mener des observations novatrices des atmosphères étendues des planètes proches. CUTE est la première mission spectroscopique dédiée aux exoplanètes de la NASA et a collecté 6 à 11 transits de chacune des 10 exoplanètes à courte période. Je conclurai la présentation en décrivant la prochaine mission MANTIS, un CubeSat 16U qui effectuera des observations simultanées d’étoiles proches dans quatre bandes spectrales, de l’EUV à l’optique (~10 – 600 nm).
Kevin France, Université du Colorado
est professeur au LASP/Université du Colorado. Ses recherches portent sur les exoplanètes, leurs étoiles hôte, et l’instrumentation pour l’astrophysique ultraviolette. Il est le principal investigateur de nombreuses missions suborbitales et de petits satellites, et travaille actuellement au développement du concept HWO de la NASA.


12 mars, 2026
Aalto suite (Titre à préciser)
Abstract
Jaan Praks, Université d’Aalto
est professeur associé et travaille dans les domaines de la télédétection par micro-ondes, de la modélisation de la diffusion, de la radiométrie micro-ondes, de l’imagerie hyperspectrale et du SAR avancé. Il dirige le programme qui a conduit au développement des deux premiers satellites finlandais.
Printemps
09 avril, 2026
SWING – Météo de l’espace et ionosphère : une génération de nanosats
Le webinaire présentera les satellites Hemeria, en mettant l’accent sur SWING : Space Weather and Ionosphere, la génération Nanosat.
S’appuyant sur ANGELS, une plateforme 12U qui a fait ses preuves pendant cinq ans de mission à haute disponibilité, et sur Kineis, une constellation IoT de 25 satellites démontrant un système très efficace de 30 kg, Hemeria développe actuellement des plateformes GEO et d’observation de la Terre plus grandes.
SWING hérite de Kineis et transporte quatre charges utiles au service de l’ESA et de la communauté météorologique spatiale. À partir de 30 exigences de mission, Hemeria et son consortium conçoivent un satellite et un système complets pour fournir des produits L1 sur le flux de rayons X solaires, la densité et la température électroniques, les flux de particules à haute énergie et le sondage ionosphérique via l’occultation radio GNSS. Le lancement est prévu pour mars 2027.
Le webinaire détaillera le contexte du projet, les instruments et le concept du système garantissant une latence de 30 à 60 minutes et une haute disponibilité.
Il présentera enfin la future constellation météorologique spatiale inspirée par SWING.
Pierre-Yves Guidotti, Hemeria
ingénieur en chef chez Hemeria pour les nanosatellites depuis 2023. Il a été architecte satellite pour les 25 satellites Kineis et est désormais responsable du projet SWING pour l’ESA. Il possède 20 ans d’expérience en GNC et en systèmes au CNES, puis en tant que responsable des études avancées chez Airbus DS.

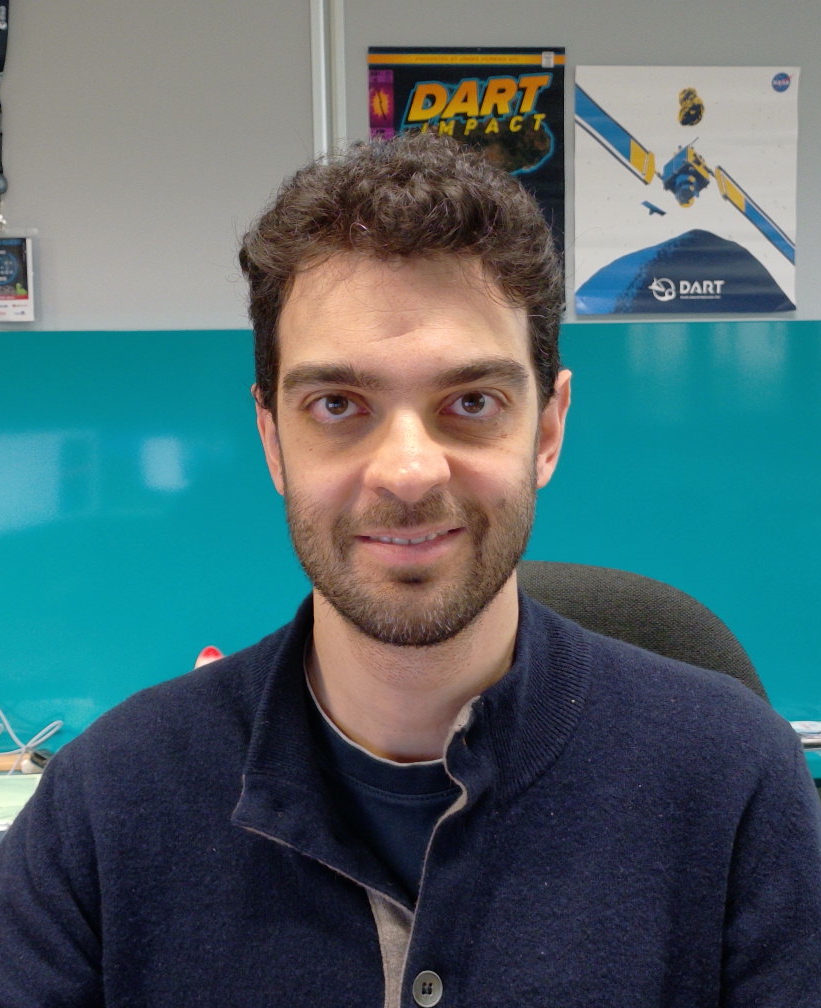
21 mai, 2026
La mission LUMIO : détection des flashs d’impact depuis la face cachée de la Lune
Le Lunar Meteoroid Impact Observer (LUMIO) est une mission CubeSat conçue pour étudier les impacts de météoroïdes sur la Lune. Développé dans le cadre du programme de soutien technologique général de l’Agence spatiale européenne, LUMIO est un CubeSat 12U qui fonctionnera à partir d’une orbite de halo autour du point L2 Terre-Lune, fournissant des observations continues de la face cachée de la Lune. LUMIO est dirigé par le Politecnico di Milano et soutenu par l’Agence spatiale italienne (ASI), l’Agence spatiale norvégienne (NOSA), l’Agence spatiale britannique (UKSA) et l’Agence spatiale nationale suédoise (SNSA). LUMIO a passé avec succès les phases A et B et se trouve actuellement en phase C, son lancement étant prévu en 2028.
En détectant les flashs d’impact lunaire (LIF), ces brefs éclats de lumière produits lorsque des météoroïdes frappent la surface de la Lune, LUMIO étendra la couverture de la surveillance des impacts au-delà des télescopes terrestres, qui sont limités à la face visible et affectés par les conditions météorologiques.
Fabio Ferrari, Politecnico di Milano
est professeur associé au Politecnico di Milano et professeur invité à l’Université de Bern. Il contribue à l’équipe scientifique de la mission NASA Dart et de celle de l’ESA, Hera. Il est le principal investigateur scientifique de la mission ESA Lumio.
11 juin, 2026
Améliorer le succès des CubeSats : le rôle de l’ESA dans la fourniture d’infrastructures et d’expertise pour les essais des CubeSat
L’Agence spatiale européenne (ESA), principalement par l’intermédiaire du centre ESTEC et de son réseau, fournit un soutien essentiel en matière de vérification au sol et de qualification pour les CubeSats, améliorant ainsi leur taux de réussite. Cette infrastructure centralisée réduit considérablement les risques liés aux missions des petits satellites et accélère leur niveau de maturité technologique (TRL).
Les principaux domaines de soutien détaillés sont les suivants :
- Essais environnementaux : accès aux installations de l’ESTEC, telles que les grandes chambres thermiques sous vide (TVAC), les chambres de vibration et acoustiques, ainsi que les salles blanches spécialisées, pour la vérification au niveau du système.
- Essais CEM/Gauss : utilisation des installations blindées de l’ESTEC pour une conformité rigoureuse aux normes de compatibilité électromagnétique (CEM) et de décharge électrostatique (ESD), essentielles pour la propreté magnétique et les performances des capteurs d’attitude.
- Banc d’essai du système de détermination et de contrôle d’attitude (ADCS) : mise à disposition du banc d’essai ADCS de l’ESTEC, équipé d’une plate-forme à coussin d’air, pour simuler la microgravité et le champ magnétique terrestre afin de réaliser des essais dynamiques en boucle fermée des algorithmes et des composants ADCS.
- Assurance de la résistance aux rayonnements (RHA) : l’ESA coordonne l’accès aux installations d’irradiation par protons et ions lourds, y compris le soutien à la décapsulation au niveau des composants (« delidding ») des pièces COTS pour la qualification dans l’environnement de rayonnement spatial.
- Caractérisation des systèmes de propulsion : accès aux installations de l’ESTEC pour effectuer des essais de systèmes de propulsion électriques et chimiques dans des chambres à vide et caractériser les effets de couplage des plateformes.
Le cadre de l’ESA offre un service essentiel de bout en bout qui favorise l’innovation dans le domaine des petits satellites.
Simone Simonetti, ESA
est ingénieur système au centre ESA ESTEC aux Pays-Bas, specialisé dans les nanosatellites et missions deep space. Il dirige plusieurs projets clés dans le domaine de la technologie des petits satellites au sein de la division TEC-SIU de l’ESA.
